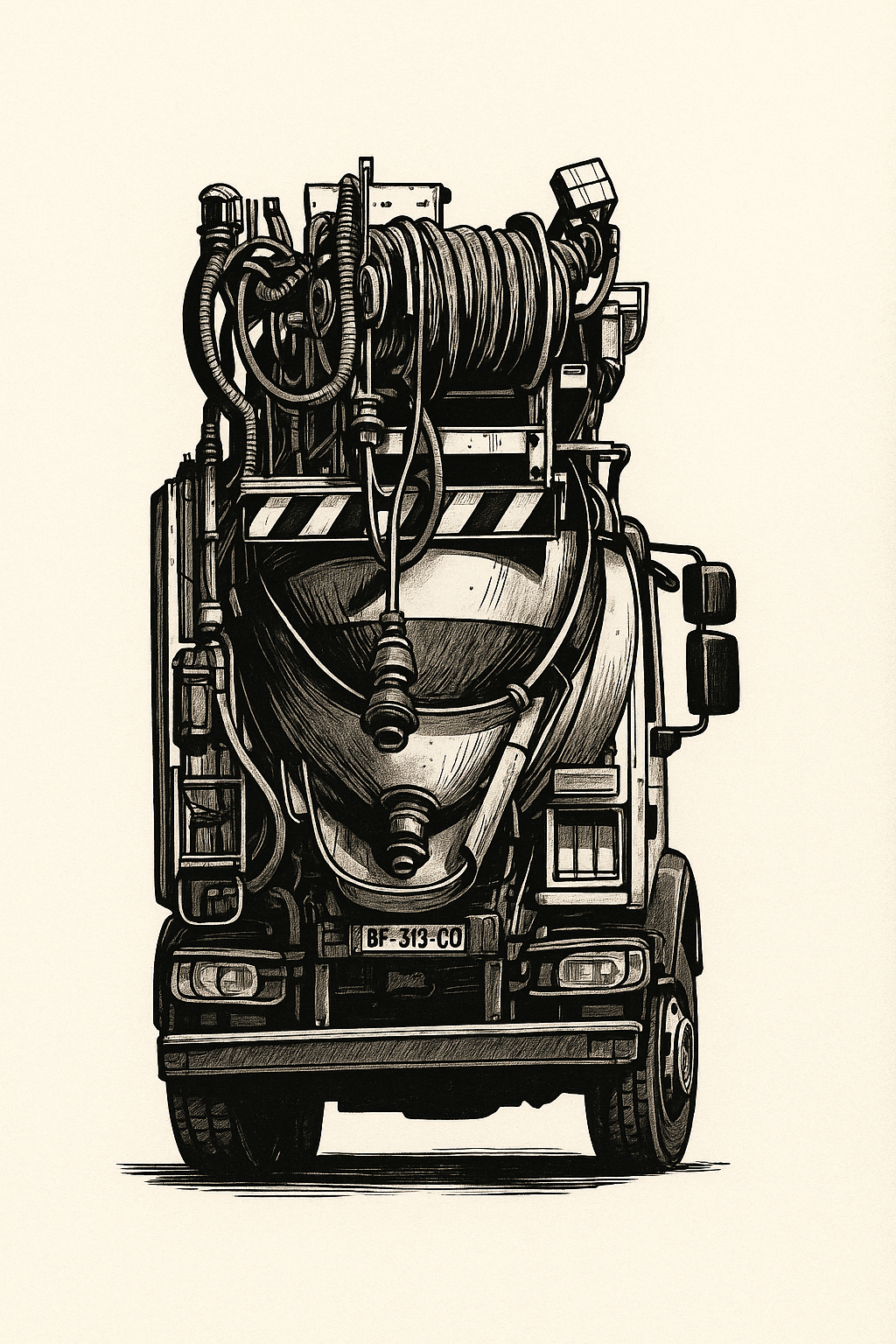On ne fait plus des enfants. On s’enchaîne.
Sous couvert d’amour, on s’enferme. Sous prétexte de transmettre la vie, on abdique la sienne.
Dans la société moderne, avoir un enfant, c’est signer un contrat invisible : « Tu seras à moi. Tu renonceras. »
À quoi ? À ta liberté. À ton sommeil. À ton énergie. À ta spontanéité. À ta marge de manœuvre.
Le couple devient une PME sous tension. Deux salariés, deux agendas pleins, une seule vie à gérer. Et le gosse là-dedans, c’est le troisième associé, celui qui impose sa loi. Chaque jour, c’est une course. Chaque semaine, un sprint. Chaque moment de calme est payé au prix fort.
Un ami, jadis libre, flamboyant, m’a dit un jour avec les yeux cernés : « Je pourrais pas faire comme toi. J’ai deux enfants, faut assurer. »
Traduction : « Je suis pris au piège. »
Les enfants deviennent les chaînes parfaites. Plus solides que n’importe quelle politique de contrôle. L’État n’a même plus besoin de répression : il te tient par l’instinct de parent. Finies les démissions salvatrices, les départs vers l’inconnu, les reconversions radicales. Tu restes là, tu subis, parce que t’as des bouches à nourrir.
Et même quand tu t’es libéré du salariat, la cloche retentit à nouveau. L’école devient ton nouveau maître. Tu croyais t’en être sorti, mais non : dépôt à 8h15, récupération à 16h30. Oublie les journées souples, les projets qui débordent, les matins calmes. L’enfant est un métronome impitoyable.
Regarde les villes à l’heure de pointe. Les bouchons ne mentent pas : tout le monde a les mêmes horaires. Des files entières de parents au bord du burn-out, les nerfs tendus, les visages fermés, chacun déposant sa progéniture à la même heure, au même endroit. C’est une angoisse. Une mise en scène de masse. Une pièce de théâtre morne où les figurants rejouent tous la même scène.
Moi ? Je refuse ce rôle.
Je ne suis pas un figurant dans cette petite vie minable, standardisée, réplicable à l’infini. Je ne vivrai pas sous la dictature des sonneries de cour d’école.
Et pendant ce temps, les amis sombrent. Ceux qui brillaient, qui avaient de l’élan, de la folie douce dans les yeux… ils ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Sortir prendre un verre ? Un enfer d’organisation. Il faut désigner qui aura le droit d’y aller ce soir-là. Jamais les deux. L’autre reste à la maison. Ils arrivent en retard, repartent tôt, la voix lasse, l’énergie absente. Ils ne vivent plus, ils tiennent.
Ils répètent que ça vaut le coup. Mais quand je les regarde, je vois surtout qu’ils essaient de s’en convaincre pour ne pas s’effondrer.
On peut tout justifier. L’amour, la transmission, la filiation. Peut-être que c’est vrai, peut-être que ça sauve de quelque chose. Mais ce que je vois, c’est une génération sacrifiée sur l’autel de la conformité. Une génération qui confond le devoir avec l’annulation de soi.
Je ne juge pas. Mais je refuse.
Je refuse de m’agenouiller devant un idéal qui me broie. Je refuse de sacrifier ma vie sur l’autel des conventions.
Si un jour j’ai un enfant, ce sera sans m’oublier. Sinon, à quoi bon transmettre la vie si c’est pour la vivre à moitié ?